ILS LUTTAIENT ASSIS / Robin Petit-Roulet
Concours littéraire de la Bibliothèque de l'ISTOM 2014 - Catégorie Nouvelle (Thème le vieux barbu) - 1er Prix.
Ils luttaient assis / Robin Petit-Roulet
Mon père est assis sur la
terrasse, ma mère étend le linge dans le jardin. Elle porte sa belle robe rouge
mais mon père ne la regarde pas vraiment. Le soleil est haut dans le ciel, il
règne une atmosphère paisible.
C’est la même photographie que
j’observe depuis bientôt trois ans. Je la connais par coeur mais je ne peux
partir sans l’avoir scrutée de fond en comble une dernière fois. Je pense que
j’aimerais retrouver ce moment-là si jamais je meurs. Ce n’est pas mon plus
beau souvenir mais je l’associe à mon enfance, à tout ce que j’ai pu vivre
avant. Et je n’ai pas besoin de beaucoup d’explications pour dire qu’avant
l’Irak, ma vie était mieux.
Je suis assis à l’arrière d’un
Humvee, véhicule de transport de troupe, avec quatre camarades. L’ambiance est
très tendue. Hier soir, une explosion dans une rue passante a fait trois morts.
Il faut laver cet affront. Nos chefs nous ont envoyés capturer deux terroristes
dans leur cache dans les montagnes. Nous devons aller vite pour éviter de nous
faire repérer et perdre la trace des islamistes ou pire, tomber dans une
embuscade.
Le caporal essaye un jeu de
mots mais personne ne répond, les soldats sont à bout de nerf. Pour beaucoup
d’entre nous, cela fait trop longtemps que nous sommes ici. Le pire ce n’est
pas les combats, nous y sommes préparés c’est notre métier. Le pire c’est
l’attente dans la peur. Les blagues du caporal ne font rire que lui, nous ne
les écoutons plus.
Les trois Humvees de la
délégation s’arrêtent. Nous savons qu’il ne nous reste plus que quelques
minutes pour neutraliser les terroristes. Je descends du véhicule, serre mon
fusil Famas et m’enfonce dans la forêt. Nous glissons entre les arbres, sans
bruit, en direction de la petite cabane de berger située à près de cinq cent
mètres. Des lumières dansent à l’intérieur. Nous n’avons pas été trompés, il y
a bien quelqu’un. Peu à peu, nous nous écartons et encerclons la maison. Deux
hommes parlent, ce sont eux. Le caporal fait signe aux soldats de me couvrir.
Je me place dos au mur, à côté de la porte en bois. Je peux entendre crépiter
le feu. J’essaie de distinguer le ton des voix. Les deux hommes parlent
calmement, j’arrive même à reconnaître le mot « chèvre », ils ne nous ont pas
repérés. Deux soldats me rejoignent. Nous ouvrons la porte brutalement. Des
cris. Les Irakiens sont surpris. Ils ne sont pas armés. Rapidement, nous les
plaquons au sol. Ils crient. Je les somme de se taire. Ils ne s’arrêtent pas.
Nous essayons de leur lier les mains mais soudain l’un d’eux s’agrippe à ma
cheville. Ils crient. Je tire.
Le soir, de retour au camp,
nous comparons les visages de ces corps et le signalement des terroristes. Nous
avons été trompés. Nous aurions pu être pris à revers facilement. Nous avons eu
de la chance cette fois-ci.
Le caporal nous offre deux
jours de repos. C’est le genre de décision que je bénissais en formation. Je
pouvais rentrer chez moi, retrouver mes amis et le calme de la maison. Mon père
ne parlait pas souvent mais je sentais qu’il faisait un grand effort lorsque
j’étais en permission. Il me racontait la vie du quartier, les résultats
toujours de plus en plus décevants de son équipe de basket préférée et
finissait avec les derniers faits divers relatés dans son journal. Mais à
chaque fois il évitait deux sujets : la politique et l’armée. Je le revois,
assis sur sa chaise, sur la terrasse, le regard lointain. Ce ne fut pas un père
confident mais je sais qu’il m’a aimé et ce n’est qu’aujourd’hui que je
remarque combien sa présence était apaisante.
Les journées de repos au camp
se ressemblent toutes. Nous essayons de joindre nos familles et nos amis mais
le décalage horaire est trop grand et je dois me résoudre à envoyer quelques
messages sur Facebook. La vie des autres est tellement différente de la mienne que je ne reste jamais longtemps connecté.
Je jette un coup d’oeil par la fenêtre en sortant de la salle informatique. La
rue devant le camp est vide. Depuis que nous sommes installés ici les habitants
ont fui le lieu, craignant les heurts et les exactions de la part des
terroristes ou des soldats. Les champs de l’autre côté de la rue ne sont plus
cultivés, les herbes folles qui y poussent ne sont plus fauchées que par les
passages de véhicules ou les explosions. Pourtant aujourd’hui, quelqu’un marche
sur cette route. Un vieil homme barbu porte une chaise. Il avance jusqu’à
l’entrée du camp, pose sa chaise sur le bord de la route et s’assoit. L’Irakien
est assez âgé, ce qui est rare. Sa tête est entourée d’un turban sombre. Ses
habits sont propres et bien taillés.
Le garde s’approche de lui,
son fusil à la main. Je ne comprends pas bien ce qu’il dit au vieil homme, il
s’énerve, brandissant son arme. L’Irakien semble calme, il n’a pas peur du
garde. Le soldat le somme de partir, il fait de grands gestes, le pousse, le
menace avec son arme. Je rentre dans ma chambre. Je m’allonge sur mon lit quand
j’entends les cris du sergent-chef. Je me lève et regarde la rue. Le vieil
homme est toujours là, deux soldats sont en train de le fouiller, tandis que le
sergent rentre dans le camp en jurant. Les soldats finissent la fouille et
rentrent dans le camp à leur tour. Le vieil homme se rassoit sur sa chaise mais
le garde le fait reculer et désigne le caniveau. Sans protester, le vieux barbu
déplace sa chaise et se place à l’endroit montré par le garde. Il s’installe
face au camp et regarde l’entrée. Le garde retourne sous la guérite, mettant de
temps en temps le vieil Irakien en joue.
En allant au réfectoire je
passe devant l’entrée du camp. La nuit commence à tomber mais le vieil homme
est toujours là. Il semble regarder l’intérieur du camp bien qu’on ne puisse
presque rien apercevoir à travers la lourde grille de l’entrée. Je continue ma
route.
La discussion du repas –
l’efficacité du nouveau lance-grenade MK 19 – ne m’intéresse pas, l’attitude du
vieux barbu m’intrigue. Que fait-il là ? Aucune idée. Est-ce une nouvelle sorte
de menace terroriste ? Impossible de le savoir. Porte-t-il une bombe ? Non, il
a été fouillé. Mais alors, qu’est-ce que cet homme trafique ? Qu’attend-il de
nous ? Est-il chargé de nous espionner ?
Je décide de me rendre auprès
du soldat chargé de la garde ce matin pour en savoir plus mais celui-ci est
déjà dans sa chambre. Mes questions devront attendre demain et je m’endors avec
l’image du vieil homme dans la tête.
Ce matin, en descendant dans
la cour pour le lever de drapeau je ne prends pas mon parcours habituel et
passe devant l’entrée. Le vieil homme est toujours face au camp, assis sur une
chaise dans le caniveau. Il semblerait qu’il n’ait même pas bougé.
Des femmes passent dans la
rue. Leurs pas sont pressés, leurs gestes nerveux. On pourrait lire la peur
dans leur façon de marcher. Le chemin le plus court entre les habitations et le
puits passe devant le camp mais les Irakiens nous évitent et préfèrent devoir
marcher une heure que de passer devant nous. Les femmes ne peuvent courir sans
attirer l’attention mais il est certain qu’elles donneraient tout pour que le
passage devant l’entrée soit le plus rapide possible. L’une d’elle se retourne
pour observer le vieil homme. Elle cache son visage avec ses mains comme si
elle pleurait et accélère le pas.
Aussi longtemps que je ne me
souvienne, il n’y a jamais eu de drapeau des Etats-Unis à la maison. Mes
parents ont toujours voté, fêté la Thanksgiving et l’Independence Day, ils ont
toujours respecté les valeurs de notre pays mais je ne les ai jamais vus se
prosterner devant un drapeau. Depuis que je suis entré à l’armée je rattrape le
temps perdu et donne une attention toute particulière aux cérémonies de levée
et d’abaissement de nos couleurs. Aujourd’hui je me fais une remarque étonnante
: «le drapeau irakien, il ressemble à quoi ?».
La cérémonie terminée, je vais
à la salle de musculation. C’est un des endroits que je préfère dans le camp.
Les bruits, l’effort, la souffrance dans l’effort, même les odeurs. À mesure
que je frappe dans le punching-ball rouge ma tête se vide. J’en oublie même que
je frappe. Et pourtant la peau de mes poings rougit sous la violence des coups,
elle brûle mais mon esprit est ailleurs. Je frappe. La sueur qui coule
maintenant dans mon dos me transporte. Je ne suis plus en pleine guerre,
tiraillé entre la peur d’une bombe assassine et le sentiment de sécurité
qu’inspire mon matériel. Je suis un enfant, capable de tout. Je cours dans une
pelouse verdoyante, je monte aux arbres, je ris, je monte sur les genoux de mon
père.
La douleur dans mes muscles
est trop forte. Mes mains tremblent d’avoir tant frappé le cuir fatigué du
punching-ball, je le laisse en paix.
Mes questions sur le vieil
homme restent sans réponses, le soldat d’hier est parti ce matin vers un autre
camp. Je ne peux déranger le sergent-chef pour si peu et personne dans la base
ne semble intéressé par cette affaire. Je vais me reposer, ce sont mes
dernières heures de permission.
Aujourd’hui je suis de garde.
C’est un poste que personne n’aime ici. Le danger vient de l’extérieur et j’y
serais le premier confronté. En plus de ça, il fait chaud et sec. Rester dehors
dans la petite guérite, attendre, craindre. Elle est là la pire chose de cette
guerre : l’attente.
Cependant, en m’habillant ce
matin, j’ai comme envie d’aller en bas, de garder l’entrée. Si seulement le
vieil homme n’est pas parti alors je pourrais l’observer, essayer de savoir un
peu plus qui il est.
Lorsque je prends la relève,
mes espoirs se réalisent. Il est toujours là. Immobile.
Je me place dans la guérite
rouge et blanche, à l’ombre, m’assure que la rue est bien calme puis je le
fixe. L’homme doit avoir une soixantaine d’année et pourtant ses traits sont
tirés, il semble miné par quelque chose. Il ne me regarde pas. Son visage
n’affiche aucune expression de crainte, comme s’il en avait vu d’autres. Il
scrute le camp, sans bouger, assis sur sa chaise. Les longs poils de sa barbe
grisonnante volettent sur son torse. Cela fait deux jours qu’il est dans cette
position. J’ai vu des femmes lui donner à boire mais il n’a pas mangé. J’ai
pris avec moi un morceau de pain récupéré du réfectoire. J’avais l’intention de
le lui donner mais je ne voudrais pas nourrir un terroriste. L’image des deux
bergers assassinés est encore trop présente. Le sang surtout, l’odeur du sang
chaud.
Le vieil homme n’a pas l’air
hostile, il n’y a personne à proximité. Je jette le morceau de pain par terre,
sans un mot. L’Irakien ne bouge pas. J’aurais pu lancer une grenade qu’il ne
serait pas sorti de sa rêverie. Rêverie, c’est ça. Il n’examine pas un point
précis dans le camp, non, il regarde ailleurs, il voit quelque chose que l’on
ne peut observer.
Je prends mon fusil et le met
en joue. S’il n’a vraiment rien à se reprocher, il n’aura pas peur, il
continuera son petit numéro. Je le vois dans mon viseur, je charge. Le vieil
homme se tourne vers moi, il me fixe sans agressivité ni frayeur. Ses mains
sont toujours sur ses genoux, seule sa tête a bougé. Il a les yeux bleus, ils
sont apaisés. J’abaisse mon fusil et désigne le pain du bout du canon. L’homme
l’étudie puis m’observe. La situation est étonnante. C’est comme si nous étions
chacun des gardes, se méfiant l’un de l’autre ou plutôt essayant de savoir qui
était l’autre. Je garderais mon camp et lui garderait son secret. Quatre mètres
de terre battue par les roues des camions et les pas des femmes nous séparent,
c’est peu si l’un de nous possède un explosif. Le vieil homme regarde le
morceau de pain mais ne se lève pas. J’entends le moteur d’un Humvee qui
arrive. Je serre mon fusil. Il y a six mois, deux terroristes avaient pris
possession d’un véhicule, six morts. Je reconnais le conducteur. Il s’arrête à
mon niveau, me tend les papiers de mission, je lève la barrière.
Le pain est resté intact, il
est passé entre les roues du camion. Je profite du passage de ce-dernier pour
récupérer le morceau, je m’approche du vieil homme et lui tend :
« Qui êtes-vous ? Que
faites-vous là ? »
Je ne comprends pas bien ce
que me répond l’homme. Le peu d’anglais qu’il connait ne semble pas suffire à
dire ce qu’il cherche à m’expliquer. Puis il tend son bras vers le camp et me
répète « fils, fils ».
Je rentre dans ma guérite, un
garde ne doit pas quitter son poste et encore moins nourrir un Irakien. Le
vieil homme ne se jette pas sur le pain, il le savoure bouchée par bouchée avec
vivacité tout de même. Il en cache une moitié dans les replis de son vêtement.
Il me regarde, exquise un signe de tête puis repart dans sa contemplation.
Le silence est brisé par
l’arrivée d’un groupe de femmes. Elles sont voilées et portent toutes un bidon
vide. Si nous n’étions pas en temps de guerre elles pourraient se fournir dans
notre réserve mais la guerre est là. Le vieil homme les suit du regard. Leurs
têtes sont baissées, comme si elles craignaient de déclencher une bombe rien
qu’en posant les yeux sur ce qu’il y a autour d’elles. Elles avancent à grand
pas, sans un bruit. On peut imaginer leurs corps tendus sous leurs robes
amples. Arrivée au bout de la rue, une des femmes trébuche et se rattrape à une
autre.
Je ne peux me retenir de sourire.
Le vieil homme étouffe un rire. Nous nous regardons et rions ensemble
discrètement. Il n’y a personne derrière la porte du camp. Je prends ma
bouteille d’eau dans la guérite et la lance à ses pieds. Il la récupère et me
remercie de la tête.
Mon père était toujours assis.
Je ne me rappelle l’avoir vu debout que très rarement. Il se levait
généralement pour changer de chaise ou lors des grandes occasions. Quand je me
suis inscrit à l’armée, il est resté assis. Quand j’ai reçu ma lettre de
mobilisation, il est resté assis. Je crois en réalité que l’unique fois où il
s’est levé pour moi c’était pour mon premier jour d’école. Il m’avait
accompagné avec ma mère jusqu’à la grille de la cour. Il tenait difficilement
sur sa canne et n’aimait pas voir du monde. Je ne l’ai jamais remercié d’avoir
fait ça. Je ne pourrai peut-être jamais le faire. La vie a ça d’étonnant
qu’elle nous pousse irrémédiablement à suivre la route tracée par nos parents,
ou au contraire à rebrousser chemin et partir dans l’autre sens. Peu sont ceux
qui ont réussi à se perdre. Je ne sais pas si j’ai aimé mon père, à vrai dire
je ne me suis jamais posé la question. Ce n’est qu’une fois arrivé dans la
guerre que j’ai remarqué qu’il risquait de me manquer.
Je regarde le vieil homme sur
sa chaise. Comme mon père, il regarde dans le vide mais il voit. Ils ont les
mêmes yeux. Leurs vies sont sensiblement différentes.
Un soldat de deuxième classe
vient prendre ma relève. Je ne suis pas déçu de me reposer un peu mais j’avais
pris goût à la compagnie du vieil homme. Lui ne me regarde pas partir.
Ici nous effectuons des gardes
de quatre heures à tour de rôle. Le reste du temps est partagé entre nos
chambres, la salle d’entretien du matériel et le réfectoire. Après un repas
rapide, je me couche sur mon lit et m’endors sans attendre. La chaleur est
étouffante en juillet.
Je suis de retour dans la
guérite de l’entrée. Le vieil homme n’a pas bougé. Les mains sur les genoux, la
tête droite, les yeux fixant quelque chose dont je n’ai pas connaissance. «Fils» disait-il. La garde doit se faire debout. Quatre heures debout c’est
long mais c’est l’unique moyen pour que les gardes de nuit ne s’endorment pas.
Le vieux barbu, lui, est assis, face à moi. Je ne sais s’il m’a reconnu mais je
suis presque certain qu’il a arrêté sa contemplation quelques instants lorsque
j’ai repris mon poste. Ami ou ennemi ? Aucune idée. Si le sergent tolère sa
présence c’est que cet homme ne doit pas être sur nos fichiers. Qui peut-il
bien être et que fait-il ici ? La guerre lui a certainement fait tourner la
tête. Un fou. Un fou.
Je fais quelques pas pour me
dégourdir les jambes puis étends mes bras. A ma grande surprise le vieil homme
tend ses bras aussi. Je fais semblant de m’asseoir, le dos contre la guérite et
souffle. Il rigole. Je me relève.
Le vieil homme lève haut son
bras droit. Je fais de même. Puis, il fait pareil avec l’autre. Je répète
encore son geste. Les deux gardes que nous sommes, celui du peuple conquis,
assis, et celui du peuple conquérant, debout, entament alors un jeu de miroir.
Tout en retenue, lui par nature, moi pour ne pas risquer d’être repéré, nous
nous amusons à diriger tour à tour l’autre, à le faire bouger selon nos envies.
C’est presque une danse. La tête, les jambes, les mains, les bras.
Je prends mon fusil et mime un
tir. Le jeu est terminé. Le vieil homme ne reprend pas mon geste mais désigne
de son doigt l’entrée du camp. Il me montre son torse de l’autre main. Le bruit
d’un Humvee arrivant à toute vitesse nous coupe dans notre semblant de
discussion.
Un caporal conduit le
véhicule, il me tend ses papiers par la fenêtre en criant « J’ai des blessés. »
J’ouvre la barrière et appelle
le service de secours.
Deux infirmiers se précipitent
vers le camion. Je n’arrive pas bien à distinguer quelles sont les victimes. À
en croire leurs uniformes, trois soldats dont deux Allemands. Un d’eux à la
jambe droite arrachée. Beaucoup de sang coule des brancards qui les emmènent.
Mon père ne m’a jamais
beaucoup parlé mais mon entrée dans l’armée a fini de taire ses mots. J’ai mis
beaucoup de temps à savoir pourquoi. Je pensais qu’il avait peur, qu’il
craignait que je devienne comme lui, que la guerre m’emprisonne le corps et
l’esprit. J’ai pensé qu’il serait fier que je défende les valeurs de mon pays,
que je protège ses intérêts. Je pense que c’est aussi pour ça que je me suis
engagé, pour exister à ses yeux. Je n’ai fait que détourner un regard posé trop
rarement sur moi.
Un soir ma mère avait essayé
de m’expliquer. Depuis son retour du Vietnam, il n’était plus le même, il avait
laissé là-bas trois parties de son être : une jambe, son dynamisme et son âme.
J’ai cru que tout était de la faute des ennemis. Je remarque aujourd’hui que je
me suis lamentablement trompé. C’est la faute de la Guerre. Elle qui nous a
motivés, lui comme moi, qui nous a fait tirer, qui nous a fait tuer.
Mon père n’est plus que
l’ombre de lui-même mais son calme, la paix que ce soldat fait régner me manque
aujourd’hui plus que tout. À sa façon il a lutté contre mon engagement, il a
lutté contre la guerre, il ne voulait pas perdre son fils ni tuer celui d’un
autre. Il est resté assis.
Je suis couché dans ma
chambre. Je n’arrive pas à trouver le sommeil. Je suis fatigué, fatigué de la
guerre, fatigué du sang mais je ne peux fermer les yeux. Je donnerais tout ce
que j’ai pour arrêter cette guerre. Je suis exténué. Je ne veux plus voir de
sang, sentir ce liquide chaud et rouge couler. J’entends des cris. À l’entrée
du camp, un homme hurle tandis que d’autres rigolent. Je me lève et essaye
d’apercevoir ce que le maigre éclairage me laisse distinguer. Un homme à terre
est roué de coups. Trois soldats sont autour de lui et le frappent avec leurs
chaussures. Ils le relèvent et le pousse à l’intérieur du camp. Je cherche la
chaise du vieil homme. Elle est vide.
Je m’habille en vitesse et
descends dans la cour. Je ne sais ce qui me pousse à aller si vite mais j’ai
envie de savoir, j’ai peut-être même envie d’éviter ce qui va se passer. La
violence va se calmer par la violence.
Le vieil homme est couché dans
la cour tandis qu’un soldat lui urine dessus. Le nez du vieux barbu est cassé,
son visage est en sang. Je m’approche :
« - Arrêtez ! Qu’est-ce que
vous faites ?
- Casse-toi, c’est un espion,
c’est sûr.
- Ils ont tué 15 femmes au
marché aujourd’hui et on a un caporal dans le coma.
- Mais lui, il n’a rien fait,
je réponds.
- Il vient soi-disant chercher
le corps de son fils, le berger que tu as tué lundi. C’est faux.»
Un soldat de seconde classe
agrippe le vieil homme par une cheville et le traîne sur le sol en direction du
garage. Il prend un pied de biche et frappe les genoux du vieil homme. Les os
ne tiennent pas sous les coups du soldat.
J’essaye de l’arrêter.
J’essaye de parler. La violence n’entend rien et le soldat frappe de plus belle
sur les mains du vieil homme couché à terre.
Un des soldats me tend une
arme : «Tiens, tu as su faire le fils, tu pourras faire le père. Dans quel camp
es-tu ?».
Je serre l’automatique dans ma
main. Je regarde le vieil homme. Les soldats m’encouragent, virulents. Le
deuxième classe au pied de biche se relève vers moi. Le vieil homme est en
sang, son corps n’est que douleur mais son esprit ne lâche pas. Il tiendra.
Malgré les coups, malgré les doigts brûlés, malgré les dents arrachées et les
yeux éclatés, il tiendra.
Je tire.
Je suis assis sur une chaise.
Le vieil homme est sûrement mort à cette heure-ci. Je ne l’ai pas tué. J’ai
changé l’arme de main et j’ai tiré à la base de mon index, la douleur était
terrible. Les chairs brûlées, déchirées, les tendons coupés, les os broyés par
la balle.
Mon père est venu me voir au
procès. Il est resté debout.
Le courant
s’allume. Noir.
(Robin Petit-Roulet, ISTOM).
(1er Prix Catégorie Nouvelle, concours Littéraire BIBLIOTHÈQUE ISTOM 2014)
(Robin Petit-Roulet, ISTOM).
(1er Prix Catégorie Nouvelle, concours Littéraire BIBLIOTHÈQUE ISTOM 2014)
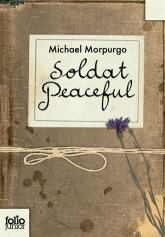







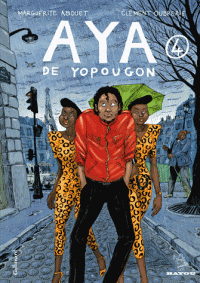

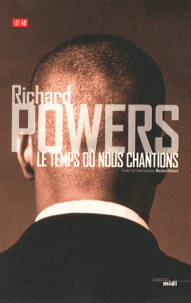
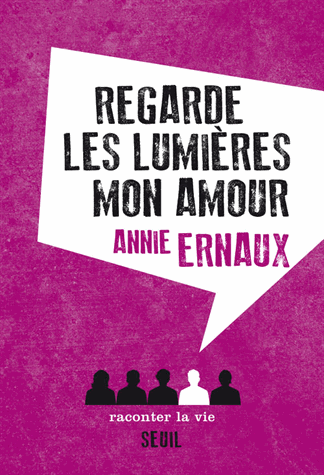



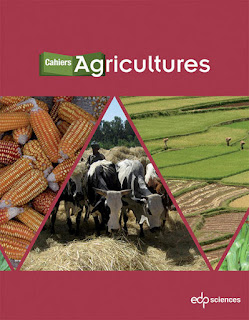

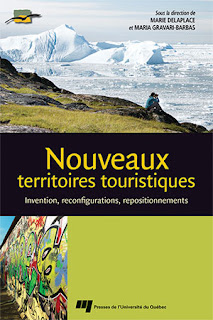
Commentaires